Lynda.com a récemment posté une vidéo appelée Before there was Photoshop — Avant Photoshop — [mais il aurait été préférable de l’appeler Avant InDesign] pour fêter la 25e anniversaire du logiciel phare Photoshop. La vidéo présente rapidement comment on préparait les documents pour l’impression avant le travail sur ordinateurs. La vidéo n’est pas tout à fait claire, et il y a quelques approximations, mais ça donne une idée….
Personnellement, j’ai commencé à faire de la mise en page sur ordinateur avec le logiciel MacDraw – un logiciel de dessin vectoriel disponible dès 1984 sur les premiers Mac. À leur sortie j’ai utilisé PageMaker [de chez Aldus] puis Quark XPress. PageMaker et XPress n’étaient pas les premiers logiciels de mise en page pour des ordinateurs personnels, il y avaient eu d’autres avant.
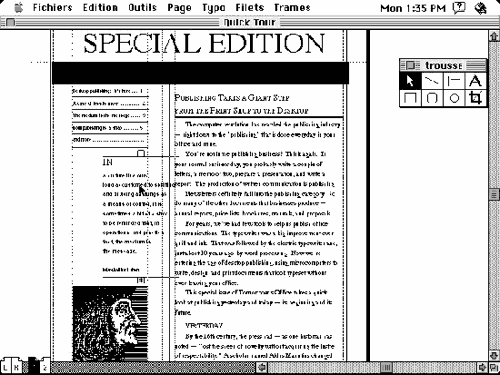
Aldus PageMaker / DR
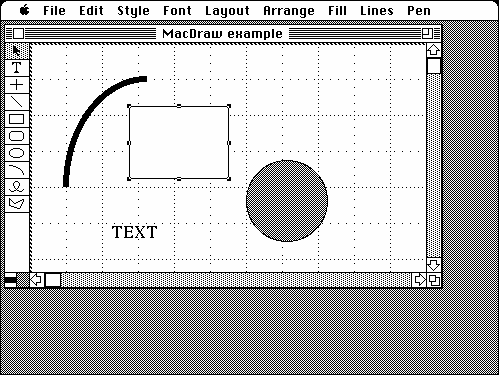
MacDraw / DR
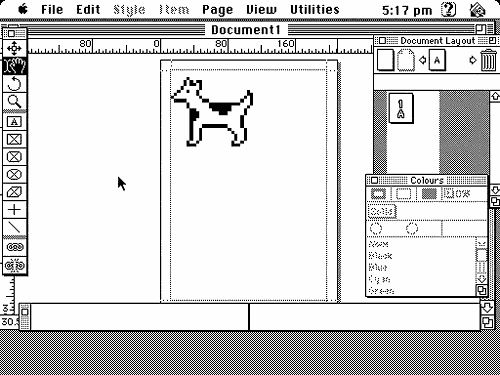
QuarkXPress / DR
Il est simpliste d’affirmer qu’ils avaient du succès grâce à leurs interfaces graphiques [GUI – Graphical User Interface], mais c’est plus complexe que ça. Des tentatives antérieures utilisaient des séquences de codes complexes pour régler les choix typographiques — polices, styles, tailles, interlignage et interlettrage, taille des colonnes, etc. — qui ressemblaient à la manière de travailler des photocompositeurs. Et certains de ces logiciels utilisaient un GUI. PageMaker et XPress avaient du succès non pas parce qu’ils utilisaient un GUI, mais parce qu’ils étaient construits à partir d’un savoir tangible émanant du travail dans le vrai monde, ce qui se reflétait à l’écran. C’étaient les premiers à utiliser les métaphores de mon travail. J’avais un plan de montage où je pouvais placer les éléments avant de les positionner sur la surface de ma page. Je savais comment manipuler ces éléments sur mon plan de travail, je savais donc comment le faire sur écran. Une fois que ce premier pas était franchi, les utilisateurs pouvaient avancer pour aborder des actions qui n’avaient pas d’équivalents dans le monde réel — sélectionner du texte pour le transformer, dupliquer un élément, annuler une opération… Mais c’était le savoir du métier, le savoir du monde réel qui fournissait la porte d’entrée.
Bruner m’a convaincu que l’apprentissage avaient lieu tout d’abord de manière environnementale et par étapes — que c’était mieux d’apprendre quelque chose kinesthésiquement [dans l’action], puis iconiquement [sa représentation symbolique], puis, à la fin, le savoir intuitif sera en place afin de permettre les processus plus puissants, mais moins présents symboliquement, de donner de leur mieux…
— Alan Kay, cité par Bill Moggridge dans Designing Interactions.
Avant InDesign
En 1984 je travaillais en tant que graphiste freelance à Orléans. J’exposais aussi mon travail artistique ; des œuvres aussi bien sous forme traditionnelle — gravure, peinture, dessin — que sous forme électronique — installations avec ordinateurs, travail sur photocopieur [ce n’était pas à proprement parler un travail numérique car les copieurs, par exemple, étaient encore analogiques]. En tant qu’artiste travaillant avec des photocopieurs j’ai été invité à participer à une exposition collective — Les Journées de l’Image — à Saint-Jean-de-la-Ruelle, une commune de la banlieue ouest d’Orléans.
L’événement avait lieu en avril. J’ai passé un bon moment à rencontrer d’autres artistes et intervenants, ainsi que le public, mais le point fort pour moi a été ma première rencontre avec un Mac.
Comme la plupart des gens intéressés par les ordinateurs de l’époque, j’avais lu des articles sur cette nouvelle machine ‘révolutionnaire’, dévorant la presse informatique [eh oui!] de l’époque pour la moindre parcelle d’information. J’avais vu la pub iconique — 1984 — à la télévision. Mais je n’avais pas encore vu un Mac ‘pour de vrai’, encore moins eu la chance et le temps de le manipuler.
C’était une boutique informatique du coin qui avait été invité à s’installer à un stand et le public pouvait venir, saisir la souris, lancer MacPaint [par exemple] et jouer. La machine était extraordinairement populaire mais comme j’étais présent toute la journée, et tous les jours, je pouvais attendre qu’il y ait moins de monde et aller [re]faire un tour. Il va sans dire que j’ai adoré cette machine tout de suite.
Jusqu’à ce moment, mon travail de graphisme et mon intérêt pour les ordinateurs suivaient deux chemins parallèles. Même si mon acitivité professionnelle consistait à créer des pages-écrans pour le Minitel, mon travail de graphisme ‘pur’ se passait sur papier — en fait sur du carton, pour être exact, donc clairement ancré dans le monde analogique et tangible. Mais en jouant avec ce Mac, j’ai vu immédiatement de quelle manière il pouvait devenir une extension de son corps et son esprit, comment il aplanissait les difficultés et ouvrait de nouveaux champs d’exploration. J’en voulais un !
J’ai mis de l’argent de côté et, quelques mois plus tard, je me suis présenté à la boutique de ce même vendeur informatique où j’ai rempli un chèque assez important avant de porter une boîte toute aussi importante vers le coffre de ma voiture. Et voilà, maintenant j’avais mon Mac. J’ai dû retourner au magasin par la suite pour acheter une imprimante matricielle. Puis rebelote l’année d’après pour faire la mise à jour vers ce qu’on appelait un ‘Fat Mac’ — un changement de la carte mère, de nouvelles ROMs, plus de mémoire… Enfin, quand elles sont arrivées sur le marché, j’ai acheté une imprimante laser et je pouvais enfin faire du travail de qualité professionnelle avec.

Le Macintosh en 1984 / DR

Le LaserWriter / DR
Mais, pour comprendre comment le Mac a tout changé — et cela est dit sans hyperbole — il est nécessaire de comprendre la production graphique qui se passait avant 1984/1985.
Supposons que je voulais travailler sur un simple flyer, au format 21×29,7 cm. On produisait d’abord un ‘rough’. C’était une représentation du document fini mais tout dessiné à la main avec des feutres et des Rapidographs [stylos à encre de Chine pour le dessin technique]. Même les lettres pour le titrage étaient dessinées à la main. Le client approuvait le document et il fallait passer en production.
Pour les roughs simples, rapides et pas chers, tout était fait sur un papier courant avec des feutres à base d’alcool et des stylos. Dans ce cas, le ‘body’ ou corps du texte serait simulé soit par des traits simples, soit par des X et des O, dessinés à la main. Pour des travaux plus sophistiqués, et donc plus chers, le rough pouvait utiliser des lettres à transfert, voire des transferts spéciaux fait sur mesure par une entreprise spécialisée et figurait sur le même type de papier qui allait être employé pour le document une fois imprimé pour mieux simuler l’aspect et la finition. Le body pouvait être des photocopies de la police choisie dans le bon corps et la bonne interligne, et repris à partir des volumineux catalogues que les ateliers de photocomposition nous donnait, à la fois pour faire leur pub, mais aussi pour nous aider à préparer la copie. On pouvait aussi acheter des caractères de transfert, généralement de la marque Letraset, pour la taille et la police voulue, mais qui ne contenaient que le célèbre ‘Lorem ipsum dolor…’.
Comme pour le travail fini, les roughs étaient souvent présentés sur un carton avec une feuille de calque collée par-dessus [sur un bord seulement] qui servait à la fois de protection, mais aussi pour laisser le client faire des annotations. Ça ne se faisait pas d’annoter le document directement car, c’est facile à comprendre, ils étaient déjà assez chers à produire.
La première chose à faire était de préparer le carton. On utilisait un carton surfacé d’environ 3 mm d’épaisseur. Sur une face il y avait tracé un quadrillage en bleu très clair. Ce bleu s’appelle le bleu ‘inactinique’ — les caméras qu’utilisait le photograveur [une étape plus tard dans le processus] étaient plus sensibles sur le rouge [appelé ‘actinique’]. Ce bleu pâle donc était utilisé pour faire figurer des choses — traits, informations — qu’on ne voulait pas voir sur le document fini, car la caméra ne la voyait pas. On avait aussi des mines pour les porte-mines de ce même bleu.
Le carton était toujours plus grand que le format afin de tenir compte des débords et traits saignants — des éléments qui allaient jusqu’au bout du bord du document une fois imprimé. À cause des imprécisions de l’impression, il fallait toujours faire déborder ces éléments d’au moins 5 mm. La première chose à faire sur le carton était donc de tracer le format — en bleu — puis de mettre en place — avec un Rapidograph noir de 0.3 mm d’épaisseur — les traits de coupe [aussi appelés les ‘hirondelles’].
J’avais une grand table à dessin avec une règle T sur le côté. Le carton était scotché sur cette table pour garder la même équerre et les même repères. Sur la table il y avait une lampe à angle afin de bien illuminer le travail, ainsi que toute une série de boîtes avec les crayons, stylos et plumes, gommes, ruban adhésif, mais aussi des cutters et des scalpels, du brunissoirs [pour les lettres à transfert], des petites règles et courbes…
Une fois les traits de coupe en place, et l’encre sèche, je prenais ma règle en métal et mon triangle pour délimiter les blocs de structure de mon travail avec la mine bleue. On devait tenir les règles, triangles et courbes très propres pour qu’ils ne laissent pas de traces sur le document. À cette fin, la plupart des studios avaient de gros rouleaux de papier absorbant pour les essuyer et les nettoyer régulièrement. Il était aussi courant de se laver les mains plusieurs fois par heure, encore une fois pour ne pas laisser de traces sur le document.
Supposons que le flyer comprenne quelques photos, un gros titre, de la copie et d’autres bouts de texte ici et là, et un logo.
Selon le complexité du travail le titre pourrait être préparé avec des lettres à transfert. Certes, les lettres étaient en noir, mais ça n’avait pas d’importance, tout ce qui devait être imprimé figurait en noir [ou rouge] sur les documents. Si un traitement spécial était nécessaire, ou une police particulière était requise, alors le travail était préparé pour un atelier de phototitrage.

Fournitures et équipement : [de G à D ] nuancier BenDay ; feuille de lettres transfert avec brunissoir : stylos Rapidograph / DR
Pour préparer le titrage, on devait chercher le catalogue pour le fournisseur, noter la police, le style ainsi que les dimensions, puis préparer un croquis du traitement et/ou effets [ombres, contours, déformations…] à effectuer. Parfois la commande pouvait être faxée chez le fournisseur, mais souvent on devait appeler un coursier. Il arrivait par scooter pour prendre l’enveloppe qui contenait le croquis, les explications et le bon de commande. Dès réception à l’atelier de titrage, parfois le chef de prod’ [ou parfois le chef de trafic] appelait pour faire préciser des détails, discuter du prix et des délais. Le lendemain, toujours par coursier, le pli arrivait au retour avec le titre tiré sur du papier photographique et généralement accompagné du négatif qui avait servi à le produire.
Dans l’atelier de phototitrage, la commande pouvait avoir subi plusieurs traitements et manipulations optiques, produisant à chaque fois négatifs et positifs intermédiaires, ainsi que de la retouche et du nettoyage pour préparer le document final. Toute correction ultérieure imposait de reprendre le travail à partir d’une des étapes intermédiaires comme il n’y avait pas de technique pour préserver un travail en cours. Tout était dans la finesse et l’habileté des opérateurs et des machines de titrage qui devaient étirer et courber des formes de lettres, jouer avec les approches, rajouter des effets — soit photographiquement, soit à la main — et interpréter la demande initiale au mieux de leurs capacités.
Le texte pour le body devait être calibré. Ce travail commençait avec le choix de la police, le style, la variante, la force du corps et l’interligne. Le texte devait être frappé proprement à la machine, puis annoté avec des signes de préparation. On notait la largeur de la colonne ou du bloc. Ensuite, on devait compter le nombre de signes, consulter les tables d’encombrement dans les catalogues de photocomposition afin de savoir le nombre de millimètres colonnes et ajuster l’encombrement [et éventuellement l’interligne ou la force du corps]. Encore une fois, le tapuscrit avec les annotations était soit faxé soit transporté par coursier [avec le bon de commande] à l’atelier de photocomposition.

Examples de catalogues d’un atelier de photocomposition, ici pour les machines Scangraphic / DR
Les machines à photocomposition étaient des meubles importants de la taille d’un bureau de ministre avec un clavier et un écran [noir et vert] incorporés, connectés à un unité de flashage, tout aussi importante, qui contenait les polices [soit sous forme de plaques de verre ou de roues qui l’on devait changer manuellement pour tout nouveau lot de travail, soit par la suite, sous forme de données informatiques qui codaient les formes des lettres sous forme de pixels pour chaque taille de lettre…].
Assez souvent le claviste — l’opérateur de la machine — qui allait exécuter le travail téléphonait pour faire préciser un point de présentation, lever une ambiguïté ou prévenir d’un problème. Parfois le calibrage [qui portait souvent sur des moyennes d’encombrement] était erroné pour un travail précis et le texte pouvait être trop long ou trop court. Parfois il subsistait une faute de saisie ou une faute de frappe.
Le texte était flashé sur du papier photo, mis sous pli avec la copie, et retourné par coursier, généralement le lendemain. Il était courant pour les ateliers de photocomposition d’avoir une équipe de nuit [voire de week-end], donc il était possible d’envoyer des documents le soir et de récupérer le travail fini le lendemain matin en arrivant au bureau. Il existait une demi-douzaine de technologies diverses pour la production de texte en photocomposition, chacune avec des qualités et des polices différentes. Quelquefois on devait collaborer avec un atelier qui bousillait régulièrement le travail, tout simplement parce que c’était le seul endroit qui disposait d’une police spécifique à laquelle le client tenait absolument.
Pour le logo, le client fournissait soit un document au trait, soit un négatif à partir duquel on devait faire un tirage. Ces documents devaient être restitués une fois le travail terminé.
Une fois que les titres et les textes étaient prêts, il fallait les découper et les coller sur le carton. Au début nous utilisions un rouleau de cire chaude, qui a été remplacée ultérieurement par de la colle repositionnable en bombe — mais les deux procédés étaient plutôt contraignants [voire sales par moments]. Il y avait généralement un coin du studio dédié à l’encollage, protégé par de larges feuilles de papier mince, un peu comme la table d’examen chez le docteur, où l’on préparait ses éléments avant de les porter vers son carton pour le placement. La cire séchait en grumeaux. Elle jaunissait avec l’âge et suintait des bords du document à coller. Pour les bombes, on utilisait une hotte d’extraction en plaçant le morceau de papier photo sur le filtre du fond qui s’était encroûté par accumulation d’une sorte de corail de colle séché, avant d’asperger le dos d’une couche uniforme de colle. La hotte devait être installée dans un coin plus ou moins isolé, ou proche d’une fenêtre, afin que les vapeurs et particules de colle ne reviennent plus dans la salle. Dans le cas de débords de colle sur le document, des gommes spéciales en semelle de crêpe servaient à les éliminer.
On traçait des éléments décoratifs et des filets directement sur le carton, ou sur des feuilles d’acétate transparentes qui se plaçaient par-dessus le document et qui avaient des marques de registre sur les extérieurs permettant au [photo]graveur d’aligner les différentes parties. Selon la complexité du travail à effectuer on utilisait des règles et des triangles, ou des perroquets et des pistolets, voire un compas. Les erreurs et les taches d’encre étaient effacées par grattage quand l’encre était sèche. Pour des surfaces plus larges, on avait de la peinture blanche, ou pour noircir, une sorte de gouache épaisse couleur rouille.
Pour les photos et le logo, des éléments de placement étaient collés sur le carton, auquel on joignait les originaux que le photograveur devait incorporer dans le document fini. Pour préparer les documents de placement on disposé d’une ‘chambre claire’. Le document était placé en bas sous une plaque de verre, puis on allumait des spots très puissants pour l’illuminer. À hauteur de poitrine on avait une plaque de verre dépoli encadrée par un rideau. On plaçait une feuille de papier calque sur le verre, et avec une règle on mesurait les dimensions de l’image projetée sur le verre dépoli. Des manivelles permettaient de rapprocher ou d’éloigner le plateau du bas, ainsi que l’objectif photo qui projetait l’image sur le verre dépoli, et donc de régler les dimensions afin d’atteindre la taille voulue. Ensuite on traçait la forme sur le papier calque en faisant attention à inclure les parties reconnaissables. Ce morceau de calque était ensuite découpé pour être collé sur le document, ou monté sur une feuille d’acétate collée par-dessus le carton et positionnée correctement au regard des éléments qui étaient déjà présents.
Une fois le travail terminé, une feuille de papier calque était placée par-dessus le carton et les feuilles d’acétate. Avec des feutres de couleur on indiquait les couleurs à employer dans le document. Le calque était annoté pour indiquer si les traits noirs devaient être imprimés ou s’ils ne représentaient que des plis ou des découpes. Les couleurs étaient consignées en CMYK [Cyan, Magenta, Jaune (Yellow), Noir (BlacK) – appelé BenDay d’après l’inventeur du procédé] en se référant à de gros livres qui présentaient les différents points de trame dans toutes les combinaisons possibles de cyan, jaune, magenta, et noir dans des variations de 10% [parfois 5%] sur des types de papier différents [généralement couché ou mat]. Avec le temps, des graphistes expérimentés connaissaient des centaines de ces combinaisons par cœur et n’avaient qu’exceptionnellement besoin de consulter les livres.
Si les photos avaient besoin d’être retouchées, on les collait sur du papier calque et l’image était annotée pour indiquer les parties à rajouter, retirer, renforcer ou diminuer. Le négatif était placé dans une enveloppe protectrice que l’on scotchait sur le bord du papier calque pour ne pas l’égarer. Chaque photo devait avoir sa référence que l’on indiquait sur le papier calque au bon endroit [mais bien sûr les erreurs se produisaient toujours].
Parfois le carton monté était présenté au client pour une vérification de dernière minute avant de passer chez le photograveur car refaire l’étape de gravure coûtait pratiquement le même prix que de reprendre le travail depuis le début. Et donc les vérifications de dernière minute apportaient des corrections de dernière minute. Parfois les corrections étaient si importantes que l’on devait décoller des parties du carton et les faire recomposer. Parfois les changements et corrections étaient mineurs, et avec le scalpel on devait découper des lettres, les réajuster, ou encore changer des traits d’union. La colle repositionnable trouvait ici sa justifiaction. C’était tout un art de trancher ce papier photo, d’enlever des lettres et des mots, puis de repositionner tout en camouflant tous les changements.
On assemblait carton, photos, notes et bon de commande pour les expédier chez le photograveur qui se servirait de ces éléments comme base pour générer les films négatifs de chacune des couleurs — généralement pour le cyan, le magenta, le jaune et le noir — scanner les photos puis les coller physiquement dans les trous découpés dans les films. À la fin, un opérateur inspectait les négatifs sur une table lumineuse et bouchait tous les trous non voulus avec la gouache rouge [ou des bandes adhésives rouges pour coller ou joindre des parties]. La couleur rouge bloquait la lumière plus efficacement que le noir sur le négatif.
À cette époque les photograveurs préféraient encore des ektas [photos] de taille 4×5 pouces [102×127mm]. Les tirages au format 35mm [24×36 mm] étaient considérés comme insuffisants à cause de la qualité des optiques. Les machines commençaient juste à devenir des calculatrices dédiées — pas encore les ordinateurs que nous connaissons aujourd’hui — et elles coûtaient des centaines de milliers de francs.
Quand ce travail était fini — ce qui pouvait prendre une nuit pour un format A4 facile, ou une semaine pour un travail complexe de retouche et de gravure — l’atelier de photogravure nous expédiait une épreuve. À ce stade, le graveur gardait les négatifs.
Tout d’abord il fallait vérifier l’épreuve pour s’assurer qu’elle était conforme à la demande. Parfois même il fallait faire des corrections à ce stade, car c’était la première fois le document était visible, assemblé et en couleur, tout le travail ayant été effectué jusque-là en noir et blanc, jusque là.
Une fois l’épreuve approuvée par le graphiste, elle était envoyée au client pour la signature du BàT [bon à tirer]. L’épreuve tentait d’imiter le plus précisément possible l’aspect du document final pour qu’elle puisse servir de guide. À la signature du BàT, l’épreuve devenait un document contractuel prêt pour l’impression [toute correction après le BaT était à la charge du client].
Les films — positifs ou négatifs, selon la demande de l’imprimeur — étaient expédiés chez l’imprimeur avec l’épreuve. Parfois une feuille de papier calque avec des consignes était collée sur l’épreuve pour indiquer des traitements spéciaux, la présence de vernis, d’encres spéciales, de découpes, ou de corrections légères de dernière minute que l’imprimeur pouvait exécuter au moment de préparer les plaques pour l’impression.
Mon exemple ne présente qu’un projet simple. Imaginez la complexité quand on rajoute des formes de découpe, des tons directs, des encres spéciales ou de l’estampage, des vernis sélectifs… Ou imaginez la tâche pour produire un hebdomadaire de 64 pages en couleur. C’était un quantité plus qu’impressionnante de travail faisant intervenir de dizaines de métiers et des techniciens spécialisés ainsi que des machines tout aussi spécialisées et chères.
Voici donc la situation en 1985 quand j’ai acheté une imprimante laser pour étendre les possibilités de mon Mac…
